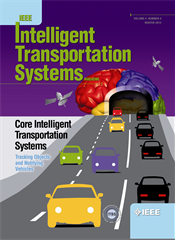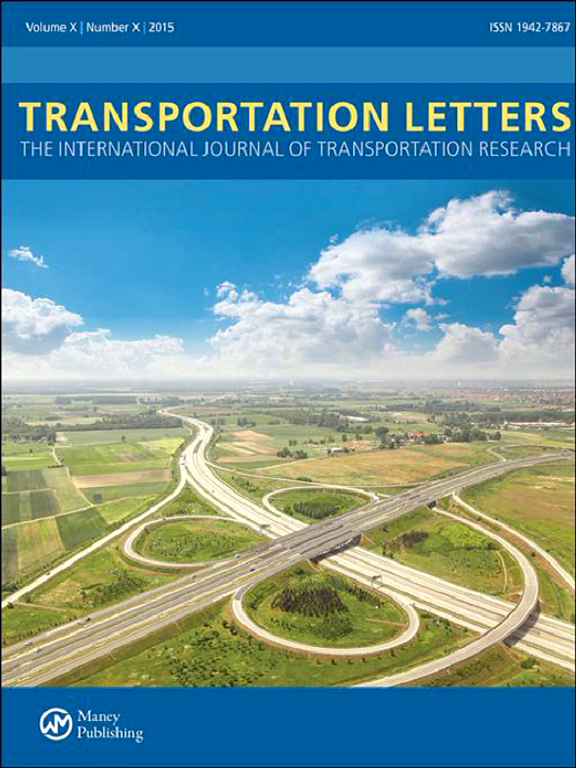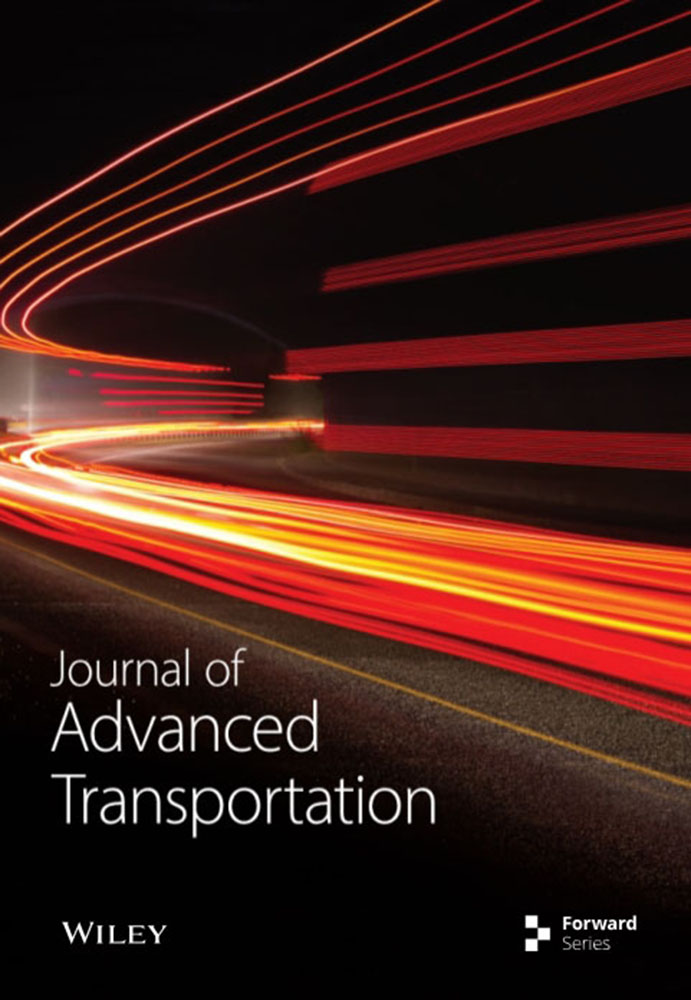Des scénarios de « sobriété carbone » pour la mobilité
Par individu et par ménage, la mobilité se réalise au quotidien et aussi, au cours de l’année, sous forme de voyages. La consommation de mobilité se conçoit en équipements privés (véhicules, abonnements), en parcours modaux, en temps passé et en argent dépensé. Elle dépend des localisations – lieux de domicile, lieux de travail ou d’étude, lieux des activités pour divers motifs (achats, affaires, loisirs…).
La localisation résidentielle « couple » la mobilité et le logement, dont la consommation se mesure en surface habitable du logement et en dépense d’argent. Par ménage, les consommations de mobilité et de logement forment un ensemble marqué à la fois par des contraintes et des options, des choix.
En moyenne parmi les ménages, les dépenses absolues croissent avec le revenu : mais, proportionnellement au revenu, les taux d’efforts sont plus grands pour les revenus modestes, et ce, avec un poids marqué des dépenses contraintes.
La thèse de Mathilde ARNAUD dirigée par Fabien LEURENT et co-encadrée par Thomas LE GALLIC interroge les consommations (de services) de mobilité et de logement par les ménages, sous l’angle de la sobriété des technologies et des usages. Sobriété en termes d’émissions de carbone générées et de niveaux physiques – taille de logement ou de véhicule, amplitude et fréquence des parcours. La thèse envisagera des scénarios de sobriété pour la mobilité, en termes de modes de vie, et ce en envisageant des transformations tant des « technologies de transport » (modes, motorisations, énergies, services) que des conditions financières d’utilisation des modes (notamment fiscales).
La thèse articule deux types de modélisations :
- la modélisation territorialisée classique pour les études de planification des transports, et
- la modélisation intégrée économie-énergie-environnement, qui est devenue l’outil essentiel pour les prospectives qui sous-tendent les prévisions du GIEC (au CIRED, modèle IMACLIM).
Cette seconde catégorie de modèles figure les ménages selon leurs diverses consommations, en interaction avec l’économie productive des différentes branches – secteurs d’activités, donc avec les emplois et les revenus associés, en interaction aussi avec les transferts sociaux et fiscaux, qui transforment la distribution des revenus et ce parmi l’ensemble des ménages. L’Ile-de-France tient une place majeure dans le système au plan national, comme moteur économique (un tiers de la richesse créée, près d’un quart des emplois, pour un cinquième de la population), et ce avec des conditions très singulières : densité de population, tailles moyennes des logements, temps passé à se déplacer, exposition à la fois aux économies d’agglomération et aux déséconomies (pollution ambiante…).